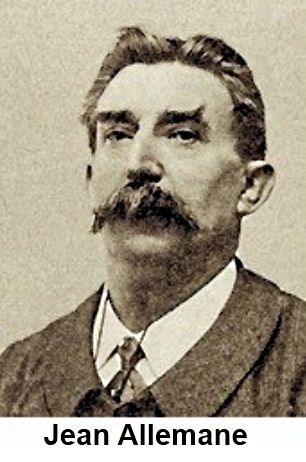Le
Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, plus brièvement appelé parti « allemaniste » du nom de l’un de ses principaux animateurs, Jean Allemane, est issu d’une double scission du mouvement socialiste
français renaissant : celle de 1882, qui avait consommé la division des guesdistes et des possibilistes — Allemane et les futurs allemanistes sont alors du côté de Brousse contre Guesde, accusé
d'autoritarisme — ; celle de 1890 qui, à la suite du congrès de Châtellerault, avait séparé des broussistes (Fédération des travailleurs socialistes de France) les amis d’Allemane qui fondaient
le POSR.
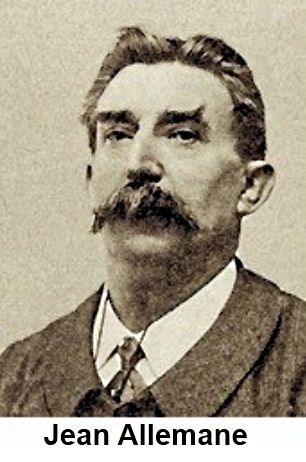
En
quelques mois, le parti allemaniste prend vigueur, notamment dans le Jura, dans les Ardennes, grâce à l’activité inlassable de l’ancien communard Jean-Baptiste Clément, mais tout particulièrement
à Paris et dans le département de la Seine, où, tenant le haut du pavé socialiste pendant quelques années, il obtiendra cinq élus aux élections législatives de 1893. Le parti, qui jouit d’une
large audience dans les syndicats et qui attire à lui les courants révolutionnaires réfractaires au marxisme, est alors à son apogée. En 1896, il traverse une crise caractéristique de ses
tendances profondes, à l’occasion d’un conflit mettant aux prises ses militants et certains de ses élus lassés d’être tenus la bride courte par ceux-ci ; démissionnaires, ces députés fonderont
l’Alliance communiste révolutionnaire avant de rejoindre les blanquistes dans le Parti socialiste révolutionnaire. C’est en 1896 encore que les allemanistes affirment avec éclat leur originalité
par rapport aux autres fractions du socialisme français, lors du Congrès international de Londres. Avec les syndicalistes et les représentants des bourses du travail, ils font bloc contre ceux
qu’ils qualifient de « politiciens » au rang desquels ils dénoncent aussi bien Guesde que Jaurès, Millerand et Viviani. Ils revendiquent alors les droits supérieurs d’un « syndicalisme
révolutionnaire » sur ceux, méprisables, du « socialisme parlementaire ».
Cependant,
l’unité du socialisme français est en marche. D’abord rétifs, les allemanistes vont s’en faire les chauds partisans au moment de l’affaire Dreyfus. Entrés en campagne bons premiers parmi les
socialistes dans le parti de la révision dreyfusiste, ils mettent beaucoup d’ardeur à dénoncer les conseils de guerre et à défendre la République menacée par la contagion nationaliste. Leur
attitude intransigeante dans l’Affaire leur vaut une défaite aux élections de 1898 — en même temps que Jaurès, dans lequel ils voient désormais un allié. Ils se retrouvent, de fait, à ses côtés,
lors du Congrès de la salle Japy de 1899, quoique les représentants du parti soient divisés sur le cas Millerand. Ils restent avec Jaurès et les indépendants lors du départ des guesdistes, puis
des blanquistes. Mais, après le Congrès de Lyon de 1901, ils vont à leur tour se retirer sur l’Aventin : ce sont eux qui, lors de « l’affaire Madeleine » (la communion qu’on reproche à Jaurès
d’avoir laissé faire à sa fille), ont mené au sein du Comité général la bataille la plus violemment anticléricale et antijaurésienne ; ce sont eux qui provoquent un débat sur la présence d’élus
socialistes aux fêtes données en faveur du tsar en visite à Paris — débat à l’issue duquel, en compagnie de certaines fédérations socialistes autonomes, ils quittent à leur tour le Comité général
socialiste en janvier 1902.
Réduit
à ses seules forces, considérablement amenuisées par la constitution des deux partis socialistes rivaux de Jaurès et de Guesde, le POSR a perdu le rayonnement qu’il avait connu dix ans plus tôt.
Représentés au Congrès d’Amsterdam de 1904, les allemanistes participent au Congrès unificateur de la salle du Globe en 1905. Mais beaucoup d’entre eux (Bourderon, Guérard, Lévy, pour citer les
plus connus) animaient déjà, depuis ses origines, la Confédération générale du travail, où ils avaient contribué à assurer la défaite des guesdistes.
Ces
quelques repères chronologiques étant fixés, qu’est-ce que l’allemanisme ? D’une formule rapide, nous dirions volontiers : l’allemanisme, c’est un anti-guesdisme. Mais, comme cette définition
lapidaire pourrait prêter à équivoque, ajoutons sans tarder que les positions du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire tournent le parti de Guesde à la fois sur sa gauche et sur sa droite.
Contrairement au possibilisme qui est un antiguesdisme de droite, l’allemanisme s’est doublement opposé au guesdisme tantôt par ses rapprochements tactiques avec les partis « bourgeois » tantôt
par ce qu’on pourrait appeler avant la lettre un « gauchisme » résolument hostile au modèle social-démocrate suivi par Guesde.
Précisons
d’abord ses tendances révolutionnaires : ce sont elles qui lui ont donné son originalité, lorsqu’en 1890 les partisans d’Allemane ont rompu avec ceux de Brousse qu’ils jugeaient acquis à une
politique et à une pratique réformistes. Pour schématiser, nous retiendrons trois traits distinctifs de l’allemanisme qui apparaissent fondamentaux :
1) L’allemanisme s’affirme comme un socialisme « anti-autoritaire ».
«
Ce qui distingue l’allemanisme, écrivait L. de Seilhac, c’est l’anonymat et la discipline. » De fait, l’allemanisme est d’abord l’affirmation d’un égalitarisme ombrageux, soupçonneux pour tout ce
qui s’élève au-dessus du rang, et donc particulièrement exigeant à l’égard de ses mandataires. Héritiers de la sans-culotterie, se réclamant du Manifeste des Égaux, les allemanistes s’inspirent
aussi de la Commune de Paris dont maints d’entre eux ont été d’actifs artisans, à commencer par Jean Allemane. Évoquant l’anniversaire du 18 mars, Allemane écrivait en 1896 : la Commune « fut comme la revanche de l’anonymat,
c’est-à-dire du peuple des travailleurs, sur la caste des dirigeants ou gouvernants ». Ces droits de l’anonymat, du peuple obscur, des sans-grades, les allemanistes les ont revendiqués non
seulement contre les rémanences bonapartistes de la République bourgeoise mais encore contre tous les aspects élitaires, personnels et centralisateurs du mouvement socialiste. S’ils sont
anti-marxistes, ce n’est pas parce qu’ils contestent l’analyse économique de Marx — ils savent à l’occasion lui rendre hommage —, mais parce qu’ils récusent la prise en main du mouvement
révolutionnaire par une poignée de dirigeants qui se sont arrogé la direction du parti. C’est pourquoi, en 1882, ils sont du côté de Brousse qui affirme : « Je suis de ceux qui, tout en étant
communistes, voudraient un parti formé sur la base de la distinction des classes et dans lequel les groupes évolueraient avec la plus entière liberté de doctrine et de tactique. Autonomie et
fédération sont pour moi les deux bases de l’organisation d’un Parti ouvrier. » Mais cette défiance vis-à-vis de Guesde se retourne en 1890 contre Paul Brousse, accusé à son tour de mener un jeu
personnel. Contre les « individualités » de tous ordres, l’allemanisme défend le double principe de la structure fédérale du parti et du futur État socialiste, pour éviter les empiètements d’une
direction centrale abusive, et du mandat impératif, contre les tentations politiciennes des élus.
Être
élu (conseiller municipal ou député), c’est être toujours un peu suspect aux yeux des militants allemanistes. Ceux-ci s’acharnent à mener la vie dure à tous ceux qui y parviennent. Leurs
candidats doivent, avant leur campagne électorale, remettre une démission en blanc à leur fédération régionale, démission qui sera déposée en leur nom auprès des pouvoirs publics dans le cas où
ils auraient trahi leur mandat. C’est ainsi qu’en 1896, l’Union fédérative du centre (région parisienne) n’hésite pas à faire usage de leurs démissions en blanc à l’encontre des conseillers
Faillet et Berthaut et des députés Dejeante et Groussier, tous quatre ayant invoqué leurs charges familiales pour se dispenser de rétrocéder à la caisse de la fédération la partie de leur
indemnité parlementaire qui leur était imposée.
Le
parlementarisme est en effet une des bêtes noires du POSR.
S’il accepte de participer aux campagnes électorales, c'est seulement « à titre de propagande ». Rien ne lui répugne plus que l’idée d’un socialisme établi par une majorité parlementaire,
organisé par des orateurs, constitué par en haut. En ce sens, ils sont bien proches des communistes libertaires, ces allemanistes, « adversaires acharnés des propagandistes d’un collectivisme
d’État, qui serait plus terrible que l’État ploutocrate nous régissant ».
Cette
défiance des caciques les fait volontiers passer pour « ouvriéristes » même s’ils comptent dans leurs rangs des intellectuels de valeur. Il est remarquable en tout cas que, longtemps avant la
thèse émise par R. Michels sur la « loi d’airain » de l’oligarchie dans les organisations démocratiques, ils aient été si vivement sensibles aux processus d’accaparement du pouvoir par les
orateurs, les intellectuels et les députés dans les partis ouvriers. Beaucoup de leurs réunions se passent à contrôler les faits et gestes de leurs mandataire, jusqu'au ridicule, mais, le recul
aidant, nous pouvons sur ce point rendre un juste hommage à leur précoce lucidité : leur phobie de l’arrivisme avait assurément quelque chose de prophétique. D’autant qu’à côté de leurs exigences
parfois mesquines les allemanistes ne manquent pas de propositions pour rendre concrète l’émancipation des travailleurs « par les travailleurs eux-mêmes » : à preuve la campagne qu’ils mènent, au
Congrès international de Zurich, en faveur de la législation directe. Leur projet préconisait la suppression des Parlements centraux et leur remplacement par un législatif décentralisé jusqu’à la
commune, jusqu’à la section (autant de sections par commune que de milliers de citoyens), jusqu’au citoyen : « Cela marque la fin de tout despotisme administratif ou gouvernemental : c’est le
peuple maître absolu de ses destinées » (Allemane). Six ans plus tard, Fabérot réaffirmera au Congrès de Japy cette volonté d’autonomie libertaire : « Je n'aime pas ceux qui veulent commander aux
autres... Nous ne voulons pas de commandants, nous voulons être tous commandants et soldats ».
2)
La révolution par la grève générale.
Constamment,
les allemanistes ont affirmé le rôle secondaire de l’action « politique » — « une action très précieuse, très importante, mais qui ne doit pas dominer les autres » (Albert Richard à Japy). Le
principal est l’organisation du prolétariat par lui-même, sur le terrain de la production, où s’exerce par excellence la lutte de classe. C’est là, face à face avec le patronat, que naît la
conscience de classe ; le syndicat en est l’instrument privilégié. Là, pas de compromission, pas de combinaison : par la revendication et la grève, par « l’agitation économique et sociale » le
prolétariat prend la mesure de sa solidarité et de sa force. Vouloir s’emparer du « pouvoir central » avant que le prolétariat soit la « force dominante » c'est mettre la charrue devant les bœufs
et, qui plus est, préparer la voie à un socialisme d’État, dirigé par quelques-uns. La révolution doit partir d’en bas par un lent travail de propagande et d’organisation qui doit aboutir à la
grève générale.
Sur
la notion de grève générale, qui est toujours restée à l’ordre du jour de tous les congrès nationaux du parti, les avis ont varié. Certains ont insisté sur sa préparation pour ne pas la laisser «
au hasard des événements », mais beaucoup pensent qu’une grève générale ne se décrète pas, comme Albert Richard, au Congrès de Japy. Quoi qu’il en soit, le mot d’ordre de la grève générale
consonne avec celui du mandat impératif : la priorité accordée aux luttes « économiques » sur les luttes « politiques » confirme la méfiance tenace que les allemanistes éprouvent au regard de
tout socialisme bureaucratisé, centralisé ou/et parlementaire. On comprend pourquoi beaucoup d’entre eux ont pu rejoindre tout naturellement les rangs d’un syndicalisme d’action directe, jaloux
de son autonomie et incarnant à ses propres yeux le mouvement révolutionnaire.
3)
Antimilitarisme, antipatriotisme.
De
toutes les fractions du socialisme français avant leur unité, l’allemanisme a été incontestablement le groupe le plus acharné, à professer la suppression des armées permanentes, à dénoncer la
justice militaire et à remettre en cause le patriotisme alibi des classes dirigeantes. Adversaires résolus de l’alliance franco-russe, accusée d’être un facteur de guerre, ils s’emploient contre
l’esprit de la revanche jusqu’à mettre en doute le caractère français de l’Alsace-Lorraine. Dans son livre sur le socialisme et la guerre, M. Drachkovitch résume ainsi l’apport des allemanistes
sur la question de la guerre : « [Ils] seront les doubles précurseurs : d’un côté, d’un courant de la grève généralisée en cas de guerre, dans le futur parti socialiste unifié ; de l’autre, la
CGT suivra l’inspiration allemaniste dans son antipatriotisme, son antimilitarisme et sa résolution [...] de proclamer la grève générale révolutionnaire au moment de la déclaration de guerre. »
Cette disposition particulière des allemanistes a certainement favorisé leur hâtive intervention dans la campagne dreyfusarde. Dès le mois de décembre 1894, soit bien avant qu’il y eut une «
affaire » Dreyfus, Maurice Charnay — auteur du Catéchisme du soldat — exprimait son scepticisme quant à la culpabilité de Dreyfus : « Le public, éternel gogo, s’est laissé prendre, comme
toujours, à ces démonstrations de fureur patriotique, heureux au fond d’être trahi, pour pouvoir être sauvé. »
Mandat
impératif, grève générale, antipatriotisme... Voilà pour l’anti-guesdisme de gauche. Mais, en certaines circonstances, les allemanistes passent les guesdistes sur leur droite. Profondément
attachés à la forme républicaine du régime politique, les allemanistes, dès que celle-ci est menacée, abandonnent aisément tout sectarisme de classe, quitte à s’allier aux éléments droitiers de
la bourgeoisie républicaine, comme en témoigne leur attitude soit lors du boulangisme, soit au cours de l’affaire Dreyfus. Là où les guesdistes refusent ou acceptent difficilement la politique de
« défense républicaine » (cf. Lafargue lors du boulangisme, cf. encore la réserve des guesdistes à l'égard du dreyfusisme), on voit les allemanistes, champions du syndicalisme révolutionnaire,
prendre parti avec promptitude pour la défense d’une République somme toute « bourgeoise ». Allemane s’est souvent expliqué, à Japy par exemple : « Chaque fois que les libertés publiques sont en
danger, le devoir des militants est de se mettre du côté des défenseurs de ces libertés publiques. Qui fait des calculs, qui attend le moment de se prononcer, ne peut se dire militant : c’est un
calculateur. » Et l’on voit, face au danger nationaliste, les irréductibles révolutionnaires mettre entre parenthèses la lutte de classe et, par tous les moyens, y compris les plus «
parlementaires », se porter au secours de la République contre « la coalition réactionnaire ». Du boulangisme au dreyfusisme, le POSR a suivi la même ligne : refuser, selon le mot de Rosa Luxemburg,
« l’abstention politique de la classe ouvrière » manifestée par les partisans de Jules Guesde, même si c’était au profit « des Jules Ferry, des Constans et de la bourgeoisie opportuniste ».
En
effet, cette politique de défense républicaine entraînait fatalement les allemanistes à faire des concessions, à accepter des compromis, à quitter provisoirement le strict terrain de la lutte de
classe. Aussi, tout se passe comme si, le danger écarté, la République sauvegardée, l’instinct révolutionnaire reprenant le dessus, les allemanistes se trouvent tout déconfits de s’être laissé
entraîner aussi loin dans la collaboration de classe et, durcissant alors leur position, ils rejettent ceux des leurs ou ceux de leurs alliés qui n’ont pas eu ou ne pouvaient avoir le même
sursaut de conscience prolétarienne et mis un terme aux compromis concédés pour un temps à la défense de la République. Le boulangisme vaincu, voilà Paul Brousse dénoncé ; le nationalisme
anti-dreyfusard défait, voici Jaurès et ses amis devenus suspects. Alors il est temps qu'on se ressource aux principes de la grève générale, à la haine des « politiciens », à la dénonciation des
« individualités ». On se retrouve entre soi, pur, dur, intransigeant, comme pour se justifier à ses propres yeux de s’être abandonné à tant de complaisance en faveur d’alliés trop
compromettants. Toute l’histoire de l’allemanisme tient entre deux crises nationalistes, où les mêmes comportements à une dizaine d’années de distance se reproduisent selon la même logique, par
une succession de coups de barre à droite et de coups de barre à gauche, qui place ses militants toujours au symétrique de Guesde, accusé tout à la fois de « trahir » la République et de résumer
« la bataille contre le capitalisme » à la conquête des sièges. On comprend dès lors ce que Jaurès a pu représenter dans cette guerre de positions.
À
la charge de Jaurès, Allemane et ses camarades ne manquent pas de griefs. Le député de Carmaux n’est-il pas ce qu’ils exècrent par principe : le bourgeois devenu chef socialiste, le député qui
voudrait en imposer aux militants de la base, l’« indépendant » qui se place hors du contrôle et de la discipline du parti ouvrier ? C'est en pensant à Jaurès que Joindy écrivait : « Mieux vaut
graviter autour d’une idée que d’un homme ». Jaurès a trop d’ampleur pour n’être pas suspect aux yeux de militants qui se sont fait une règle canonique de ne pas souffrir, selon le mot
d'Allemane, « l’amour des individus ». C’est en 1896, lors du Congrès de Londres et des semaines qui ont suivi, que les membres du POSR ont été le plus hostiles à Jaurès, accusé par eux de vouloir
privilégier dans les instances du socialisme international les droits du parlementaire sur ceux du délégué mandaté : « Les travailleurs, écrit Allemane, ont fait bloc pour se garder des
politiciens. Fédérations, chambres syndicales, bourses du travail et notre Parti ouvrier socialiste révolutionnaire ont adopté la même tactique, et, réserves faites sur quelques nuances, le Parti
marxiste français, le Comité révolutionnaire central, le groupe des élus, la Fédération des travailleurs socialistes de France ont pris même posture quant à l’interprétation de l’article 11
du règlement adopté à Zurich. »]
Mais
Jaurès s’affirme souvent un allié appréciable. Dans la lutte idéologique et politique menée contre Guesde, les allemanistes ne se font pas faute d’en appeler à Jaurès, de vanter ses mérites, de
prendre son parti contre les coups du chef marxiste. Dans son article cité plus haut, Jean Yscle écrivait ainsi contre Guesde : « Le talent de Jaurès, son ardeur, sa combativité, la largeur de
ses vues offusquèrent, gênèrent profondément le grand manitou de la conquête des pouvoirs. Dès lors, Jaurès — qui pardonna toujours — fut le point de mire de sa jalousie féroce, de la basse envie
qui est toute la raison d’être de ce puits de fiel. Il essaya de tout pour user, pour démolir le vaillant député de Carmaux, le calomniant, le tournant en ridicule dans les couloirs, le décriant
sans cesse — tout en lui faisant la meilleure mine du monde. » La sympathie à l’égard de Jaurès est en proportion de l’hostilité à Guesde. L’affaire Dreyfus fut sans doute à cet égard la période
la plus favorable à ces sentiments pro-jaurésiens. La défaite de Jaurès aux élections de 1898 y contribua : « Nous éprouvons, disait-on, une certaine satisfaction de la défaite de Carmaux, qui va
permettre à l’éloquent tribun de porter toute son activité là où les efforts des militants doivent converger, c’est-à-dire à la propagande, à l’éducation socialiste du peuple. » N’oublions pas,
d’autre part, l’influence de Lucien Herr exercée sur Jaurès, autant dans sa conversion au socialisme qu’au dreyfusisme ; or, Herr était allemaniste. Sans doute occupait-il au sein du parti une
place en retrait, celle d’un intellectuel ayant choisi un autre terrain de bataille ; en tout cas, les liens entre Herr et Jaurès témoignent de certaines affinités qui pouvaient exister entre
celui-ci et les amis d’Allemane.
Lors
de l’affaire Millerand, les allemanistes se rangèrent aux côtés de Jaurès. Non parce qu’ils éprouvaient de la sympathie pour l’entrée de Millerand dans un ministère qui comptait aussi en son sein
un général Galliffet détesté. Mais, pendant toute cette crise, ils s’acharnèrent à minimiser l’incident, à rejeter Millerand hors de la famille socialiste, ce qui épargnait celle-ci d’intervenir,
et, jusqu’en 1901, comme nous l’avons dit, ils suivirent Jaurès en raison à la fois d’une logique impliquée dans la politique de défense républicaine et de la satisfaction éprouvée à jouer Jaurès
contre Guesde. Plus tard, quand Jaurès, dans le parti unifié, reprit à son compte l’idée de la grève générale préventive contre la guerre, c’était un hommage implicite qu’il rendait à l’un des
mots d’ordre mille fois affirmé par l’allemanisme, témoignant par là même d’une tradition au sein du socialisme français trop souvent méconnue de nos jours.
Ce
fut à l’honneur du parti d’Allemane d’avoir, quand il le fallait, pris le parti sans hésiter de la défense de la République menacée par les pires dangers réactionnaires, en dépit de toutes les
répugnances qu’il éprouvait pour les « politiciens ». Ce fut et cela reste à son honneur d’avoir rêvé d’un socialisme émancipé des leaders tout-puissants et de bureaucraties parasitaires. Allier
dans un même élan l’exigence de la liberté et celle de l’égalité était peut-être une chimère, du moins les allemanistes ont-ils combattu en faveur de ce socialisme fier, sectionnaire et
prolétarien, parmi lesquels J. Jaurès eut souvent l’occasion de reconnaître des alliés, insupportables mais vrais.
Michel
Winock
http://jeanallemane.free.fr/Les_Allemanistes.html